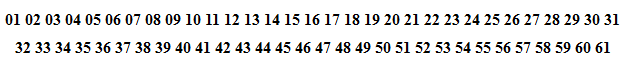Au VIIIe siècle av. J.-C., alors que
l'Egypte est affaiblie, que la Grèce, agitée par des guerres civiles, se lance
sur la Méditerranée et fonde ses premières colonies, un petit village se crée au
centre de l'Italie, Rome, qui va partir à la conquête du bassin méditerranéen,
qu'il réorganisera totalement.
 La Louve du Capitole que l'on attribue à un artiste
étrusque du VIe siècle av. J.-C., fut transférée à Rome où elle
devint le symbole de la ville. Le groupe des jumeaux, tel qu'on peut le voir,
date de la Renaissance, mais il existait sans doute dès l'origine.
La Louve du Capitole que l'on attribue à un artiste
étrusque du VIe siècle av. J.-C., fut transférée à Rome où elle
devint le symbole de la ville. Le groupe des jumeaux, tel qu'on peut le voir,
date de la Renaissance, mais il existait sans doute dès l'origine.
L'Italie, encore plus que la Grèce, fut un carrefour de
peuples. Les Ligures s'y installèrent à une date indéterminée, dans les massifs
montagneux, rejoints par les Samnites, peuples indo-européens qui envahirent la
péninsule dans la deuxième moitié du IIe millénaire. On désigne sous
le nom d' "Italiotes" ces premiers peuples, ainsi que les Sabins et Latins qui
s'installèrent dans quelques plaines côtières marécageuses comme le Latium.
Surtout bergers et guerriers, ils défendaient âprement leurs terres.
Deux grands foyers de civilisation se développent alors, l'un
au Sud à partir des colonies grecques, l'autre en Toscane où dominent les
Etrusques dont l'origine demeure encore mystérieuse (origine asiatique sans
doute) et l'écriture indéchiffrable. Les premiers temps de l'histoire de Rome
n'ont été connus pendant longtemps que par des documents iconographiques ou des
récits plus ou moins légendaires de poètes et historiens latins, comme
Tite-Live.
La légende rapporte que le Troyen Enée débarqua dans le
Latium après la chute de Troie. Il épousa la fille du roi local et leur fils
fonda la ville d'Albe. Deux de ses descendants, Romulus et Remus, abandonnés sur
le Tibre pour être écartés du trône, furent sauvés par une louve qui les nourrit
comme ses enfants.
Sur la carte de gauche, le territoire de
Rome avant (zone hachurée) et après les longues guerres samnites (343-291 av.
J.-C.).
A droite, les possessions respectives de Rome et de Carthage
à la veille de la première guerre punique (264-241 av. J.-C.).
En 753 av. J.-C., Romulus fonde la ville qui porte son nom,
après avoir tué son frère. Il attire dans la ville bergers et pillards, leur
donnant comme épouses des Sabines élevées au cours d'une fête. Dès lors, la
ville est gouvernée alternativement par des rois latins et sabins avant de
l'être par des rois étrusques (au VIe siècle av. J.-C.).
 Le site de la Rome antique :
Le site de la Rome antique :
1. la Rome "carrée", village fortifié construit sur le mont Palatin
2. L'enceinte de Rome à la fin de la royauté
3. L'île Tibérine
4. Le pont Sublicius
5. La via Nomentana
6. La via Appia
7. La via Flaminia
8. Le Tibre.
Les sciences actuelles (archéologie, ethnologie...)
permettent de mieux connaître la réalité historique. Des villages latins et
sabins, organisés en confédération, vivant d'élevage et de culture, occupent le
site des sept collines de Rome dès le Xe siècle av. J.-C. Au VIIe
siècle av. J.-C., les Etrusques envahissent le Latium et réunissent les villages
en une vraie ville avec des temples, une place publique, un mur d'enceinte, un
égout.
Ils transmettent aux Romains l'art de construire les voûtes,
les murailles, d'assécher les marais, et leurs coutumes religieuses. A la fin du
VIe siècle av. J.-C., ils sont battus par les Grecs de Campanie
tandis que le peuple latin se révolte, les chasse et fonde la république.
La société romaine de ces premiers siècles est inégalitaire.
La patriciens (du mot pater, chef de famille) descendants des
fondateurs de Rome, sont divisés en gentes, ou clans, issus d'un même
ancêtre à qui ils rendent un culte. Ils portent en général trois noms : le
praenomen correspond au prénom actuel, le nomen, équivalant au nom
de famille, indique la gens, et le cognomen, sorte de surnom,
utilise une caractéristique physique ou morale (scaurus : pied-bot;
Cicéron, de cicer : pois chiche).
A gauche : les possession de Rome en 60
av. J.-C. (premier triumvirat). Délimités par une mince ligne rouge, les
territoires sous l'influence de Rome.
A droite: l'extension de l'empire romain d'Auguste à la mort de Trajan (117 ap.
J.-C.)
1. Nouvelles conquêtes
2. Provinces impériales
3. Etats vassaux
4. Provinces sénatoriales.
Le père a droit de vie et de mort sur tous les membres de sa
famille. La mère s'occupe des affaires domestiques, de ses enfants et des
esclaves. Les patriciens sont riches en terre, ils peuvent ainsi entretenir des
"clients", anciens esclaves ou pauvres gens qui bénéficient de leur protection
et leur servent d'hommes de main, en période d'élections par exemple.
 Enseignes de manipules (mains ouvertes au sommet de la
hampe), encadrant sur un bas-relief, une enseigne de légion (surmontée de
l'aigle aux ailes déployées). L'enseigne du milieu porte une corona muralis,
distinction accordée à celui qui escaladait le premier les remparts d'une ville
ennemie.
Enseignes de manipules (mains ouvertes au sommet de la
hampe), encadrant sur un bas-relief, une enseigne de légion (surmontée de
l'aigle aux ailes déployées). L'enseigne du milieu porte une corona muralis,
distinction accordée à celui qui escaladait le premier les remparts d'une ville
ennemie.
Les plébéiens, étrangers, descendants des peuples vaincus,
anciens petits paysans, pratiquent divers métiers : entre autres, ils sont
artisans ou commerçants. Enfin, les esclaves assurent l'entretien des
patriciens. Ils sont considérés comme des objets et ne peuvent retrouver leur
liberté que s'ils sont affranchis par leur maître.
La république, instaurée au VIe siècle, est en
fait une république aristocratique dominée par les patriciens. Ils ont seuls les
moyens de se procurer des armes et de participer aux guerres. Leur puissance
économique et militaire est à la base de leur pouvoir politique. Les premiers
siècles de la république furent marqués par une série de luttes internes menées
par les plébéiens pour obtenir l'égalité juridique et politique.
En recourant aux "sécessions" (le peuple sortait de la ville
et organisait ses propres assemblées), ils obtiennent le droit d'avoir leurs
représentants, les tribuns de la plèbe, qui peuvent s'opposer au vote d'une loi
et garantir le sort des plébéiens, et qui bénéficient de l'inviolabilité :
quiconque tentait de porter la main sur eux était passible de peine de mort.
Ils obtiennent encore la codification des lois des Douze
Tables, base du futur droit romain, la participation au Sénat et l'accès à
toutes les magistratures. Pour éviter le retour au pouvoir personnel, le régime
a été établi sur le partage des pouvoirs et l'équilibre entre trois organes
politiques qui se contrôlent mutuellement.
Les comices, ou assemblées du peuple, votent des lois et
élisent les magistrats. En principe, elles sont l'expression de la souveraineté
du peuple, en fait la prépondérance appartient aux riches. Les magistrats
exercent leur charges un an, collégialement (en équipes). Le candidat doit
auparavant avoir fait preuve de sa compétence et parcouru dans un ordre bien
établi toute une série de grades (le cursus honorum) qui comportent des
insignes et privilèges particuliers (licteurs portant des faisceaux,
sièges curules).
La première étape de ces charges était celle de questeur. Le
questeur s'occupait des finances, de l'administration de la ville et de l'armée.
Les édiles assuraient la police, l'entretien de la voirie, le contrôle du
commerce, l'approvisionnement de la ville, la construction des routes et des
édifices publics, l'organisation des jeux. Les préteurs rendaient la justice et
pouvaient remplacer les consuls absents.
Les consuls exerçaient la magistrature la plus importante.
Héritiers des rois, ils cumulent le pouvoir militaire, en assurant le
commandement de l'armée, et le pouvoir civil; ils convoquent et président le
sénat et les comices. Ils donnent leur nom à l'armée et à l'année de leur
mandat, et portent la robe ornée de pourpre (toge prétexte) comme les sénateurs.
Les censeurs, dernier grade du cursus honorum,
choisis parmi les anciens consuls, s'occupent du recensement des citoyens, de
leur fortune et surveillent la moralité publique. Enfin la dictature est une
magistrature exceptionnelle : en cas de danger ou d'urgence, le dictateur
dispose de tous les pouvoirs.
Esclaves affectés au service du vin. Ce
bas-relief figure sur un tombeau romain édifié au IIIe siècle, à
Igal, près de Trèves. Les autres bas-reliefs présentent des scènes analogues de
la vie domestique.
Le Sénat, troisième organe politique de la République
romaine, était composé des chefs des familles patriciennes (d'où le nom de
patres qui leur était attribué). Il existait déjà au temps des rois.. Sous
la République, il comprend 300 membres recrutés parmi les anciens magistrats. Il
surveille la religion nationale, les finances, l'administration du territoire
public, il fixe les effectifs de l'armée, contrôle l'action des militaires,
dirige la politique extérieure. Ses avis (senatus consultes) n'ont pas
caractère de loi, mais sont en général suivis. Il est le principal organe du
gouvernement.
Pendant que ses institutions se mettent en place, Rome défend
au Ve siècle av. J.-C. ses positions contre ses voisins. Il faut presque un
siècle aux armées romaines pour arrêter les offensives des Etrusques, Eques,
Volsques, Sabins, Samnites qui leur font subir l'humiliante défaite des
Fourches-Caudines racontée par Tite-Live (IX.6). Ils subissent aussi les assauts
des Gaulois, Celtes redoutables qui s'emparèrent de Rome à l'exception de la
citadelle et laissèrent au cœur des habitants une terreur tenace.
A partir du milieu du VIe siècle av. J.-C., les
Romains prennent à leur tour l'offensive; profitant des leçons de leurs défaites
antérieures, ils battent d'abord les Samnites, puis s'attaquent aux Grecs du Sud
qui appellent à l'aide le roi d'Epire, Pyrrhus. Après des batailles indécises,
celui-ci se retire. En un siècle (milieu du IIIe siècle av. J.-C.)
l'Italie péninsulaire devient romaine.
Contrairement à l'histoire grecque, l'unité de l'Italie se
fait au profit d'une seule ville : Rome. Les peuples vaincus ont un sort
d'autant plus enviable qu'ils se montrent dociles. Certains sont groupés dans
des "colonies romaines" et bénéficient des mêmes droits que les Romains. Les
"municipes" possèdent un droit de cité incomplet. Les "attres" ne sont pas
citoyens romains. Ils sont obligés "d'avoir les mêmes ennemis que Rome". Mais
tous, municipes et alliés, deviennent progressivement citoyens complets. Un
remarquable réseau de voies permet aux vainqueurs d'administrer et de surveiller
leurs conquêtes.
Vers 264 av. J.-C., Rome commence à conquérir le bassin
méditerranéen. Elle dispose, pour cela, d'un outil efficace : l'armée.
L'armée romaine, comme l'armée grecque, n'est pas une armée
de métier permanente. Elle ne le devient qu'au début du IIe siècle av. J.-C.,
sous Marius. Dès que la patrie est menacée, tous les hommes libres de 17 à 60
ans sont mobilisés, sauf les prolétaires, non possédants, qui n'ont d'autres
biens que leurs enfants (proles). Des troupes auxiliaires sont
recrutées parmi les alliés. Cela représente 300 à 400 000 hommes environ sous
l'Empire, exceptionnellement 900 000.
L'armée romaine est essentiellement terrestre. La marine
restera toujours une faiblesse de l'équipement militaire romain. L'unité de base
est la légion qui comprend sous Marius 4 200 fantassins et 300 cavaliers. Elle
est commandée par le consul. Chacune est divisée en "centuries", subdivisées en
manipules, qui sont dirigées par des "centurions".
Ce sont eux qui sont "l'armée de l'armée romaine", et "la
plaque tournante" de la promotion sociale pour l'armée. Plus que les consuls,
ils sont doués d'une grande technicité et ils ont assuré la parfaite efficacité
de l'armée.
Celle-ci est caractérisée par sa discipline implacable. Les
généraux ont droit de vie et de mort sur leurs soldats. En cas de recul devant
l'ennemi, l'armée est décimée : un homme sur dix tiré au sort est décapité
devant tous. Les récompenses sont nombreuses, butin, décorations, et surtout le
triomphe, procession solennelle du général vainqueur jusqu'au temple de Jupiter
sur le Capitole.
L'organisation de l'armée est remarquable. Les divers
éléments de l'armement ont été astucieusement empruntés par les Romains à leurs
adversaires (épée courte espagnole, cotte de mailles et boucliers gaulois...).
Le légionnaire, lourdement chargé (40 kg) est capable de faire 25 km par jour,
car il subit un entraînement poussé. A chaque étape, il doit construire un camp
fortifié suivant un plan rigoureux, toujours identique.
L'ordre de bataille comprend 3 lignes; la première est formée
des plus jeunes, les "hastates", puis viennent les "principes", plus âgés. Tous
lancent le javelot avant de combattre corps à corps. La dernière ligne des
"triaris", ou vétérans, sert de réserve. La tactique est très variée selon les
terrains, les ennemis, les moments du combat. Les légionnaires sont fort
expérimentés dans l'art des sièges et des fortifications. Des travaux de
fortification considérables, en effet, furent effectués sous l'Empire en vue de
protéger les frontières, sur des centaines de kilomètres : "cimes" de
Grande-Bretagne, du Rhin, de Numidie, de l'Euphrate.
La conquête du bassin méditerranéen fut très rapide par
rapport à celle de l'Italie (IIIe siècle av. J.-C. - Ier
siècle av. J.-C.), et se fit par étapes.
 Lorsqu'ils colonisèrent la Sardaigne, les Romains
découvrirent les traces d'une civilisation qui les avait précédés dans l'île.
Construits pendant l'âge de bronze, les nuraghi servaient de refuge ou
de forteresse.
Lorsqu'ils colonisèrent la Sardaigne, les Romains
découvrirent les traces d'une civilisation qui les avait précédés dans l'île.
Construits pendant l'âge de bronze, les nuraghi servaient de refuge ou
de forteresse.
Rome commence par s'attaquer à Carthage, cité maritime
rivale, ancienne colonie phénicienne : ce fut l'occasion de mettre sur pied une
marine de guerre. Ces guerres "puniques" (Poenus : Carthaginois)
mettent en présence une armée de citoyens romains et une armée carthaginoise
formée de nombreux mercenaires, et des chefs militaires de grande valeur, le
Carthaginois Hannibal et le consul romain Scipion. Au terme d'âpres luttes et
d'une humiliante invasion carthaginoise, Rome est victorieuse, Carthage est
prise et rasée en 146 av. J.-C.
Les Etats orientaux, désunis mais puissants grâce à leurs
richesses, attirent les hommes politiques romains. Cette fascination et
l'ambition des généraux toujours avides de gloire expliquent en partie la
conquête de l'Asie faite au cours des IIe et Ier siècles av. J.-C. La Macédoine,
la Grèce deviennent des provinces romaines, puis l'Egypte, enfin l'Asie Mineure.
L'Asie assure la gloire des généraux Paul-Emile, Sylla et Pompée.
En outre, à la même époque, commençait en Occident la
conquête de l'Espagne. La Gaule cisalpine (plaine du Pô) est conquise également,
puis la Narbonnaise pour assurer la liaison entre ces deux régions. Alors (58
av. J.-C.), veillant à son avenir politique, Jules César, proconsul de la Gaule,
pays prospère, met en jeu toutes ses forces militaires pour anéantir toute
résistance dans ce pays et, pour ce faire, joue sur l'opposition de certaines
tribus et sur leur incapacité à s'unir.
Pourtant, en 59, la résistance est organisée par un jeune
noble, chef de la tribu arverne, Vercingétorix, qui réussit à réunir une armée
de 80 000 Gaulois. Fuyant devant les Romains, pratiquant la tactique de la
"terre brûlée", il tient César en échec pendant un an. Finalement, il se laisse
enfermer dans Alésia, où il doit capituler en septembre 52 av. J.-C. César
l'emmène à Rome et le fait figurer à son triomphe, avant de le faire étrangler,
six ans plus tard.
Les conquêtes de la République s'étendent sur le pourtour de
la Méditerranée, mare nostrum (notre mer) disent les Romains. Certains
pays (Gaule, Grèce) sont totalement conquis. D'autres gardent des zones de
résistance (Espagne). Enfin, des secteurs de la côte nord, nord-ouest de
l'Afrique, ainsi que de la côte orientale, échappent au contrôle romain.
Les territoires soumis sont divisés en provinces
confiées à des magistrats qui pouvoir militaire et civil. Ces conquêtes
permirent à Rome de s'enrichir considérablement. Le butin de guerre, les
indemnités versées par les vaincus, les tributs annuels en nature ou en espèces
prélevés régulièrement, les confiscations de territoires (terres, mines...)
effectuées par le Sénat, constituent un transfert de richesses considérables,
provenant notamment de l'Orient.
Ces biens enrichissent le trésor public (les mines d'argent
d'Espagne rapportent 250 000 deniers par jour) ou des particuliers, tels que les
consuls, (Paul-Emile recueille 70 millions en or et en argent) les proconsuls ou
propréteurs gouverneurs de province, qui profitent de l'année où ils sont en
fonction pour s'enrichir de façon éhontée comme Verrès en Sicile, les
publicains, qui ont l'affermage des impôts et réalisent d'énormes fortunes. Tous
considèrent les provinces comme leur propriété personnelle. L'incapacité de la
République d'établir un régime administratif à l'échelle de l'Empire est une des
raisons de sa chute.
Cet afflux de richesses bouleverse la société. A côté des
anciens riches propriétaires terriens qui constituent la noblesse sénatoriale,
apparaissent les "chevaliers" qui s'enrichissent par les affaires. Ce sont des
"hommes nouveaux" qui réclament des responsabilités politiques.
Les petits propriétaires terriens, qui constituent la base de
l'ancienne société romaine, sont ruinés par la guerre. Au retour, ils trouvent
leurs terres dévastées, abandonnées. Ils doivent emprunter pour les remettre en
état, ou les vendre à bas prix pour essayer d'aller trouver du travail dans la
capitale. Là, souvent au chômage, ils attendent l'aumône des riches ou de l'Etat
à qui ils réclament "du pain et des jeux" pour les sortir de l'oisiveté. Rome
grandit considérablement. Les esclaves de guerre s'y multiplient et assurent
diverses fonctions (domestiques, lettrés, secrétaires ou pédagogues, esclaves de
luxe pour distraire leurs maîtres, ouvriers).
La vie quotidienne se modifie. La nourriture, les vêtements,
le mobilier, la maison témoignent d'un luxe et d'un confort de plus en plus
grands. L'influence des mœurs et de la civilisation grecque se manifeste
également dans le goût nouveau de l'élite romaine pour la littérature et pour
l'art.
Les conquêtes n'ont pas profité également à tous. Deux
frères, Tiberius et Caïus Gracchus (dits les Gracques) se font élire tribuns au
IIIe siècle av. J.-C. pour défendre les petits propriétaires,
victimes des conquêtes. La réforme agraire qu'ils proposent vise à reconstituer
cette classe sociale terrienne, en demandant une plus juste répartition des
terres conquises, confisquées et accaparées par les grandes familles.
L'opposition de la majorité de la noblesse sénatoriale entraînera l'échec et la
mort des Gracques.
Après eux, la violence s'installe à Rome. Le régime
républicain, qui confie le pouvoir civil et militaire aux mêmes mains, s'avère
inadéquat à gouverner l'Empire. Les généraux victorieux cherchent à utiliser les
forces armées pour servir leur ambition politique personnelle. Des affrontements
très violents opposent successivement Marius et Sylla, Pompée et César, Antoine
et Octave. Chacun se cherche des appuis dans le parti sénatorial homogène, ou le
parti populaire, coalition de chevaliers révoltés contre les privilèges de la
noblesse sénatoriale, citoyens pauvres des campagnes, plèbe urbaine...
Cette dernière assure notamment le succès de C. Julius César.
Nommé dictateur à vie, ses pouvoirs lui permirent de réaliser de profondes
réformes, mais accusé de vouloir rétablir la monarchie à son profit, il est
assassiné en 44 av. J.-C.
A sa mort, les guerres civiles reprennent entre les deux
généraux Antoine et Octave. Ce dernier l'emporte sur son adversaire en 31 av.
J.-C. Le Sénat lui octroie alors le titre "d'Auguste" que l'on réserve aux dieux
et sous lequel il est désormais désigné.
Il maintient en apparence les institutions républicaines,
mais il concentre en réalité tous les pouvoirs en sa main (pouvoirs législatif,
judiciaire, militaire, financier, religieux). C'est en fait la restauration du
pouvoir monarchique qui concentre les pouvoirs entre les mains d'un seul, le
"Prince" (de princeps : le premier entre ses égaux); ce régime a été
appelé "Principat".
Entouré d'excellents collaborateurs (Agrippa, Mécène),
Auguste (27 av. J.-C.) doué du sens du bien public, de réalisme, de grande
puissance de travail, cherche à réorganiser et à développer les territoires
conquis. Il crée de nouveaux organes d'administration qui ne relèvent que de lui
(bureaux, hauts fonctionnaires...) et assure la défense et la sécurité de
l'Empire. Il restaure les cultes traditionnels et instaure un nouveau culte de
Rome associé à celui de sa propre personne.
Avec ses successeurs, l'Empire se consolide. Quatre dynasties
règnent de 14 (date de la mort d'Auguste) à 255 (assassinat d'Alexandre Sévère,
avènement de Maximin Ier d'origine barbare).
Les Julio-Claudiens (14 à 68 ap. J.-C.), tous membres de la
famille d'Auguste, ont longtemps eu une fort mauvaise réputation. Leur histoire
nous est connue par des historiens latins, porte-paroles des sénateurs pleins de
rancune contre les empereurs. En fait, malgré les tares psychiques indéniables
de certains (Caligula, Néron), ils furent en général de bons administrateurs.
Les Flaviens (de 69 à 96) mais surtout les Antonins (de 96 à
192) accomplirent une œuvre militaire, politique et administrative considérable.
Ils achevèrent l'œuvre conquérante de leurs prédécesseurs pour assurer surtout
la liaison et l'homogénéité des provinces côtières (conquête du Rhin, de la
Dacie, de la Galatie, du Pont...) et renforcèrent les frontières.
Les pouvoirs républicains traditionnels disparaissent les uns
après les autres. Le Sénat, persécuté, tenu en bride, devient une sorte de
conseil municipal de Rome. La centralisation et la bureaucratisation
s'accentuent (création du conseil du prince). L'Empire assure ainsi aux
provinces la paix, grâce à une administration saine sous la direction de
fonctionnaires honnêtes et compétents. La population et la production des
provinces s'accroissent. Leurs prospérité économique concurrence l'économie
italienne, chaque province se spécialisant suivant ses conditions naturelles.
La péninsule et Rome continuent à accaparer une bonne partie
de leurs richesses. Les ports provinciaux sont équipés à cette intention
(Boulogne, ports espagnols...) ainsi que Ostie, qui accueille les produits les
plus variés (minerais de Grande-Bretagne ou d'Espagne, textiles asiatiques,
céréales d'Afrique...). Cependant, se développe entre les provinces un courant
commercial qui échappe totalement à l'Italie.
L'importance politique de celles-ci grandit également. Trajan
(98-117), le premier empereur provincial (Germanie), achève une évolution
commencée sous César, qui tend à intégrer les provinciaux dans l'Etat romain.
Avec l'empereur philosophe Marc Aurèle (161-180), il est une des figures les
plus remarquables de cette période d'apogée de l'Empire romain.
La dynastie des Sévères (193-235) marque le début d'une crise
qui s'aggrave à partir de 235 ap. J.-C., date à laquelle l'empereur Alexandre
Sévère est assassiné par des militaires. Une période d'anarchie militaire et de
périls extérieurs s'ouvre (le Bas-Empire).
L'empereur Dioclétien (284-305 ap. J.-C.) essaie de résoudre
le problème du gouvernement d'un empire si vaste et menacé par les barbares
depuis le IIe siècle ap. J.-C. Il associe quatre personnes à la
direction de l'Empire et transforme le pouvoir impérial en une monarchie absolue
à l'orientale, avec une étiquette stricte et un cérémonial pompeux.
Les besoins financiers énormes entraînent la création de
nouveaux impôts qui pèsent sur une population en pleine régression. Une grave
crise économique s'annonce, qui nécessite le contrôle de l'Etat sur les prix et
les industries. Le développement récent du christianisme oblige encore
Dioclétien à intervenir sur le plan religieux (persécution des chrétiens).
Ses successeurs doivent faire face à tous les problèmes.
Constantin (306-337), décrète la liberté de tous les cultes, délaisse Rome et
fonde Constantinople. L'empereur Théodose fait du christianisme la religion
officielle de l'Empire qu'il divise cette fois définitivement en deux
(Orient-Occident). Chacun de ces Empires a désormais son histoire propre.
L'Empire d'Occident s'effondre en 476 ap. J.-C., à la suite de la prise de Rome
par les barbares. Les insignes impériaux sont renvoyés à Constantinople.
L'Empire d'Orient subsistera pour sa part jusqu'au milieu du XVe
siècle.
L'héritage romain transmis aux régions du bassin
méditerranéen fut considérable. Rome ayant su à la fois imposer sa propre
civilisation aux pays conquis, et rester ouverte aux apports originaux de ces
peuples.